L'observatoire de la Garonnele portail de la Garonne
Découvrez toutes les thématiques
Les thématiques de l'observatoire
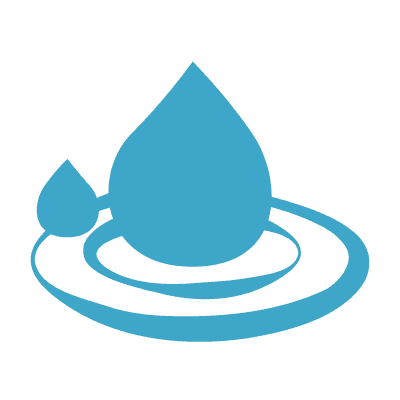
Etiage

Biodiversité
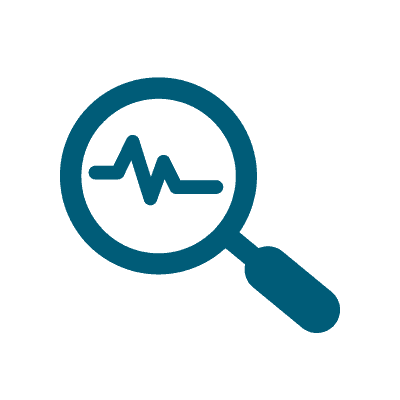
Qualité des eaux
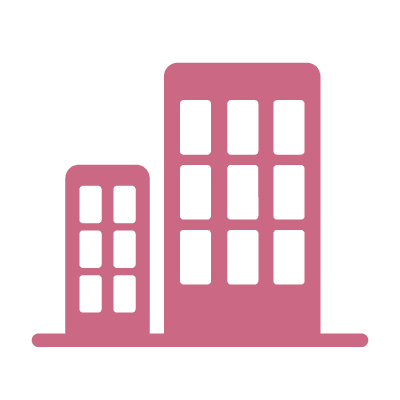
Aménagement
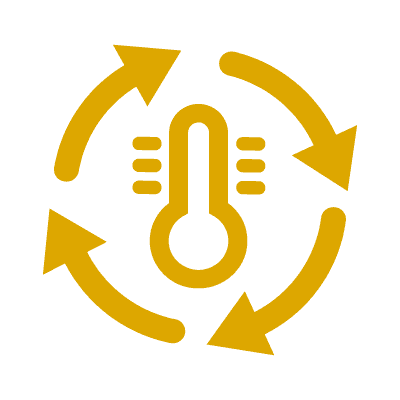
Climat

Evaluations
Données disponibles sur la plateforme
Découvrez nos actualités
Actualités

Trois contrats Natura 2000 proposés sur les bords de Garonne en Nouvelle-Aquitaine !
Contrairement en 2024, la Région Nouvelle-Aquitaine a ouvert cette année, son appel à projets en faveur des contrats Natura 2000.
A cette occasion, l'Etablissement public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens a accompagné trois collectivités dans le montage technique, administratif et financier de contrats Natura 2000. L’objectif principal est de mener à bien des travaux de restauration écologique permettant d’améliorer, de restaurer ou encore de conserver des habitats naturels favorables aux espèces classées Natura 2000.
L'Etablissement public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens a porté l’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Garonne en Nouvelle-Aquitaine » validé en 2013 et porte également l’animation du site depuis 2014. L’objectif est d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans des projets de restauration écologiques sur les bords de Garonne. Pour cela, la politique Natura 2000 est un levier intéressant car elle permet d’obtenir des subventions pour restaurer des habitats naturels et favorables aux espèces classées Natura 2000.
- Des collectivités motivés qui se réengagent :
Deux collectivités Lot-et-Garonnaises engagées dans un précédent contrat Natura 2000 ont souhaité se réengager dans cette nouvelle programmation 2023-2027 : la commune de Saint-Laurent et l’Agglomération d’Agen.
La commune de Saint-Laurent s’était engagée en 2017 dans un premier projet expérimental visant à restaurer un atterrissement en lit mineur de Garonne et la ripisylve associée avec différents travaux proposés visant l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique de la Garonne, la restauration de la ripisylve et la lutte contre la Jussie, espèce exotique envahissante. Le second contrat vise à préserver la biodiversité retrouvée sur ce site en évitant notamment la fermeture du milieu par l’arrachage de ligneux par débardage à cheval.
L’Agglomération d’Agen a également souhaité se réengager dans un second contrat Natura 2000 afin de terminer les actions du premier contrat. Une campagne de cerclage-écorçage des ligneux invasifs sera renouvelée en 2025 afin que l’opération soit une vraie réussite. Un panneau pédagogique devrait également être créé ainsi que des inventaires naturalistes (chauves-souris et libellules). - Un nouveau partenaire à l'aval de Garonne :
Le troisième projet de contrat est porté par la commune de Virelade en Gironde et concerne la réouverture d’une parcelle boisée. Les objectifs sont divers : diversification de la sous-strate arborée, création d’une délimitation naturelle par une haie champêtre, création de mares temporaires, lutte contre les ligneux invasifs par cerclage-écorçage et information du public par la pose de panneaux pédagogiques et ludiques.
Un cheminement piéton pourrait bien rejoindre cette parcelle restaurée et attirée la population locale sur un site ayant une vue imprenable sur la Garonne et l’Île de Raymond (classée Natura 2000 et Espace Naturel Sensible), située juste en face, en rive droite.
La Région Nouvelle-Aquitaine analyse les projets et par un système de notation, va attribuer les enveloppes souhaitées à certains porteurs de projets, pour mener à bien ces travaux de restauration. Durant l’été, les collectivités devraient avoir une réponse sur la possibilité de mobiliser des financements européens pour restaurer, préserver et conserver des habitats et espèces classés Natura 2000, sur les bords de la Garonne.

Mois Natura 2000
Lancement de la quatrième édition
C’est heure de la quatrième édition du mois Natura 2000 visant à faire mieux connaître la richesse écologique des sites Natura 2000 de la Garonne et de ses affluents ! L'Etablissement Public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens coordinateur Natura 2000 à l’échelle du fleuve et ses partenaires vous propose plusieurs animations du 28 septembre au 30 octobre.
Le "Mois Natura 2000" est une initiative d'envergure qui permet de mettre en lumière l'importance des zones Natura 2000 dans nos régions, en mettant l'accent sur la relation qu’entretiennent l'Homme et la nature.
Déjà 7 animations de programmées avec des opérations de sensibilisations, de nettoyage de la nature, une projection de film, et bien d’autres animations qui permettront de communiquer au plus grand nombre sur la nécessité de préserver nos milieux naturels.
Points forts de l’Evènement
- Sensibilisation aux Milieux Naturels : Des activités sportives et éducatives, des ateliers et des visites guidées seront proposés tout au long du mois pour sensibiliser le public à la diversité biologique et aux écosystèmes fragiles qui nous entourent.
- (Re)découvrir les deux régions : de la majestueuse côte atlantique aux vallées verdoyantes des Pyrénées, ces deux régions offrent une diversité écologique exceptionnelle. Le "Mois Natura 2000" mettra en lumière la richesse de ces écosystèmes.
- La Carte Interactive des événements : une carte interactive en ligne permettra aux participants de localiser et de planifier leur participation aux 8 événements répartis sur l'ensemble des régions concernées.
Pour plus d'informations sur le "Mois Natura 2000" et pour consulter la carte interactive des événements, veuillez visiter cette page : https://www.smeag.fr/focus/mois-natura-2000-lancement-de-la-quatrieme-edition.html

Maison Garonne BOE
L'Etablissement Public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens participe au sein de la Maison Garonne Boé.
Depuis juin 2023, une nouvelle Maison de Garonne est ouverte au public à BOE en Lot-et-Garonne, la troisième sur le corridor Garonnais mais la première en région Nouvelle-Aquitaine. Une exposition permanente permet aux visiteurs de découvrir l’histoire du lieu, les usages passés du fleuve, les métiers liés à la battelerie ainsi que la biodiversité associée à la Garonne. Au sein de la Maison de Garonne, divers éléments paysagers, disponibles sur l’Observatoire Garonne, sont présentés comme les zonages d’intérêts écologiques de la Garonne et son bassin versant. L'Etablissement Public Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens a participé à la conception de la cartographie exposé au sein de la maison Garonne. Au dernier étage, des trouées paysagères permettent aux visiteurs de contempler le fleuve, entièrement classé Natura 2000, de ses sources pyrénéennes à l’estuaire de Gironde.








